Différences entre les versions de « Raymond Boudon:Le Juste et le vrai »
(Aucune différence)
|
Version du 31 mai 2007 à 12:00
| Raymond Boudon | |
|---|---|
| 1934-2013 | |

| |
| Auteur libéral classique | |
| Citations | |
| "Expliquer un phénomène social, c'est souvent montrer qu'il peut être vu comme l'effet non voulu d'actions rationnelles." | |
| Galaxie liberaux.org | |
| Wikibéral | |
| Articles internes |
| Cet article a été reconnu comme faisant partie des meilleurs articles le 31 mai 2007 (comparer avec la version actuelle). Pour toute information complémentaire, consulter sa page de discussion. |
Introduction
Comment expliquer les croyances et notamment les croyances collectives ? C'est la question que se pose Raymond Boudon.
Un inventaire rapide permet d'établir une courte liste des schémas couramment utilisés par les sciences humaines classiques et modernes à ce propos.
- Le schéma des moralistes : pour La Rochefoucauld, "l'esprit est le plus souvent la dupe du coeur", ou, comme le dit Pascal, "le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas". Pareto a repris ce schéma en sociologie, et Aronson de nos jours (1).* Le schéma utilitariste ensuite : il suppose, quant à lui, que je crois bon ou juste ce qui est de mon intérêt : la démocratie passe pour bonne parce qu'elle est de l'intérêt de la classe dominante (Marx).
- Le schéma de l'imitation, de "l'automatisme", de la suggestibilité et de la contagion : il se rencontre chez des auteurs anciens, comme Le Bon ou Tarde, et chez quelques modernes.
- Le schéma de la socialisation ou de l'inculcation : il joue un rôle essentiel chez Durkheim, et les néo-durkeimiens comme Mary Douglas ou R. Needham (2).
- Le schéma psychanalytique : il fait de l'angoisse le primum mobile des représentations du monde.
- Le schéma des déficiences cognitives, de la mentalité pré-logique, ou de la pensée magique : elle est représentée, de façon ininterrompue, de Lévy-Bruhl à l'anthropologue Shweder.
On peut qualifier toutes ces explications d'"irrationnelles", car, par-delà leurs différences, elles partagent un postulat, à savoir que les croyances du sujet social s'expliquent non par les raisons qu'il se donne ou pourrait se donner, mais par des causes d'une autre nature.
Mais, même s'il ne nie pas l'importance de ces schémas explicatifs, Boudon ne fait pas siennes ces observations : une chose est de reconnaître l'existence de ces processus familiers, qui jouent effectivement un rôle très important dans l'installation de bien des croyances collectives, une autre est d'avancer qu'elles sont d'origine affective. Prenant le contre-pied de ces conceptions, Boudon estime qu'il est beaucoup plus pertinent d'analyser les croyances comme l'effet de raisons. Ce modèle, c'est le modèle "cognitiviste". Les processus de formation des croyances sont dans cette optique largement indépendants de la nature et du contenu des croyances.
D'autre part, les croyances dites "positives" (vrai/faux), même lorsqu'elles sont fausses, apparaissent comme fondées sur des principes généralement valides. Ainsi, bon nombre de ces croyances fausses dérivent de l'application de postulats apparemment aussi irrécusables que "tout effet a une cause", ou "il faut croire à ce que l'on voit".Ils constituent des guides sûrs de la pensée. Mais ils peuvent aussi être appliqués de façon malencontreuse, et, ainsi, donner naissance à des croyances non fondées.
Ce modèle cognitiviste s'appuie sur des considérations méthodologiques. Il part de la remarque que toutes les théories irrationnelles se heurtent à une sérieuse difficulté, à savoir qu'elles sont presque inéluctablement vouées à attribuer les croyances à des causes occultes. On n'a jamais décrypté les mécanismes liés à la "contagion" de Le Bon ou aux "sentiments" de Pareto. Pour mettre cette difficulté en relief, supposons qu'on veuille expliquer pourquoi un sujet croit que 2 et 2 font 4. Il serait peu satisfaisant d'expliquer cette croyance en avançant que le sujet en question a "intériorisé" cet énoncé. La bonne explication consiste bien sûr à montrer que le sujet a d'excellentes raisons de croire à l'énoncé. Mais pourquoi ne pas supposer qu'il en va de même lorsque la qualité des raisons est moins irrécusable ? Nous devons adopter un double postulat wéberien, à savoir que les croyances individuelles doivent être analysées comme faisant sens pour l'acteur, et que les croyances collectives résultent de ce qu'un individu quelconque a des raisons de les endosser personnellement. Cette perspective cognitiviste permet d'expliquer facilement une donnée phénoménologique essentielle, à savoir que le sujet a normalement un sentiment de conviction et non d'"interiorisation" ou de "contrainte".
Bloor (3) a bien senti toute la difficulté qu'il y avait à expliquer les croyances fondées par les raisons objectives qu'on a d'y croire et les croyances non fondées par des causes étrangères aux raisons que le sujet se donne. A juste titre, il a proposé d'abolir l'asymétrie entre l'explication des croyances fondées et les autres. Il propose d'expliquer toute croyance, quelle qu'elle soit, par des causes.
Pour liquider cette asymétrie, Boudon propose quant à lui une solution inverse : partir du postulat que "comprendre de manière significative" aussi bien les croyances qui nous paraissent les plus étranges que l'adhésion aux vérités de l'arithmétique, c'est dans la plupart des cas rechercher les raisons que le sujet a d'y croire.
Le modèle cognitiviste s'appuie, non seulement sur ces considérations de méthode, mais aussi sur des considérations sociologiques. On admet facilement qu'il existe dans d'autres domaines que le domaine scientifique des argumentations que tout le monde s'accorde à reconnaître comme plus ou moins défendables. Il y a une différence de forme plutôt que de contenu, de degré plutôt que de nature, entre la situation du magistrat qui doit motiver sa décision et bien des situations banales : celle de la mère qui doit pouvoir expliquer ses injonctions à l'enfant qui les conteste ou à la grand-mère qui la surveille du coin de l'oeil, voire s'expliquer à elle-même pourquoi elle s'autorise à lui infliger une réprimande ; ou celle de l'individu qui défend son point de vue dans une discussion entre amis. Le fait que le sujet doive souvent défendre ses croyances, fût-ce à ses propres yeux, suggère qu'il n'y a pas de conviction qui ne s'appuie sur un système de raisons perçues comme plus ou moins solides par le sujet.
Boudon nomme transsubjectives les raisons qui, afin d'être crédibles, doivent être vues par le sujet sinon comme démonstratives, du moins comme convaincantes. Ce sont les raisons qui ont une capacité à être endossées par un ensemble de personnes, même si l'on ne peut parler à leur propos de validité objective.
Cette notion s'applique à deux situations distinctes. La première correspond aux propositions qui relèvent du vrai et du faux, qui sont douteuses ou fausses, et qui font l'objet d'une croyance collective. La seconde est celle des croyances en des énoncés, soit qui ne relèvent pas du vrai et du faux, soit dont il est difficile d'affirmer s'ils sont vrais ou faux, et qui font également l'objet d'une croyance collective. Pour illustrer le premier cas, nous prendrons quelques exemples relevant de la psychologie cognitive. Pour illustrer le second, des exemples de sociologie de la connaissance.
Exemples tirés de la psychologie cognitive
Les travaux de la psychologie cognitive évitent toute implication affective du sujet et rendent invraisemblables les explications par les intérêts, les passions ou la mauvaise foi, de même que les hypothèses du type "imitation" ou "contagion". Les explications par les effets de socialisation n'ont pas non plus une grande place ici. Ces expériences sont en général conçues de façon telles qu'on peut comparer les croyances du sujet au vrai et déterminer avec certitude si elles s'en écartent ou non. Elles font apparaître des "croyances collectives" particulièrement intéressantes parce que énigmatiques : tout le monde ou presque pense que la proposition de X est vraie, ou X est faux. On est facilement tenté d'émettre une conjecture de type "Lévy-Bruhl" : la pensée ordinaire est soumise à des règles d'inférence illégitimes.
En fait, on peut le plus souvent analyser les résultats souvent inattendus de la psychologie cognitive à l'aide du modèle cognitiviste. Que l'inférence naturelle découvre de bonnes ou de mauvaises réponses, celles-ci ne peuvent en général être interprétées comme fondées sur des arguments que le sujet a des raisons d'appréhender comme valides.
Un exemple de consensus sur une idée fausse
On pose à des médecins la question suivante : une maladie a un taux de pénétration de 1 pour 1000. Il existe un test permettant de détecter sa présence. Ce teste a un taux de "faux positifs" (c'est-à-dire d'erreurs positives) de 5 %. Un individu est soumis au test. Le résultat est positif. Quelle est la probabilité pour qu'il soit effectivement atteint ? (4) La réponse des médecins est à la fois très structurée, et fausse. On observe un consensus ou une croyance collective franchement fausse. La plupart des médecins répondent que dans les conditions décrites, le sujet "positif" a 95 % de chances d'être réellement atteint par la maladie. Quant à la réponse correcte, elle est donnée par 18 % des médecins. (5) Il n'existe qu'une seule manière satisfaisante d'expliquer cette structuration macroscopique : la surestimation des risques auxquels est exposé un sujet positif au test tend à être endossée collectivement par les répondants, parce qu'elle est fondée sur des raisons qui tendent à être perçues comme valides. Ce sont en d'autres termes des raisons transsubjectives qui expliquent ici la structuration de l'"opinion publique" et engendrent la croyance collective. Ici les sujets "raisonnent" de la façon suivante : il y a 5 % d'erreurs, donc une surestimation de 5 % du nombre des sujets positifs au test (T) par rapport au nombre des malades réels (M).
T = M + 5 % M (1+5%)=1.05 M M = T/1.05 = 0.95 T Pr (M/T) = 0.95
Ces réponses mauvaises sont choisies parce qu'on a des raisons de penser qu'elles sont bonnes. La notion de "faux positifs" évoque celle de "faux malades", de personnes positives au test, mais qui ne sont pas malades.
|
Test Maladie |
Sont malades |
Ne sont pas malades |
Total |
|
Sont positifs au test |
100 |
5% de 100 = 5 |
105 |
|
Sont négatifs au test |
0 |
- |
- |
|
Total |
100 |
- |
100 000 |
L'interprétation sous-jacente aux réponses majoritaires
Il suffit de mettre les données sous cette forme pour voir qu'on peut interpréter "false positive rate", "taux de faux positifs", d'une autre façon : "il y a 5 % de faux positifs" peut aussi vouloir dire que "sur 100 non-malades, il y a 5 % de personnes positives au test". Le nombre des faux malades est donc de 4 995 et celui des vrais malades de 100. Ainsi, la probabilité d'être malade quand on est positif au test est, non de 95 %, mais de :
|
Test Maladie |
Sont malades |
Ne sont pas malades |
Total |
|
Sont positifs au test |
100 |
5% de 99 900 = 4 995 |
5 095 |
|
Sont négatifs au test |
0 |
94 905 |
94 905 |
|
Total |
100 |
99 900 |
100 000 |
La bonne interprétation de la question
Les sujets donnent une réponse erronée parce que la notion de "false positive rate" est ambiguë. La notion de "faux positif" est parfaitement claire. Mais c'est le concept de "taux" qui est ici ambigu : faut-il rapporter les "faux positifs" aux "vrais positifs" ou aux "vrais négatifs" ? La plupart des médecins ne se sont sans doute pas posé la question. Mais, s'ils se la sont posée, elle les a sans doute engagés sur la voie de la mauvaise réponse. La notion de "faux positifs" appelle plus facilement une comparaison avec les "vrais positifs" : n'est-il pas plus naturel de rapporter les faux positifs aux vrais, plutôt que d'introduire le chiasme "faux positifs/vrais négatifs" ? A cela, il faut ajouter que la notion de test est un "success world" : par définition, sous peine de ne pas mériter son nom, un test ne saurait être que valide. Le faible taux d'erreurs annoncé (5%) est donc interprété normalement par les répondants comme un indicateur de la validité du test. Les médecins ont donc de bonnes raisons de se tromper. Bref, la situation secrète des raisons fortes pour adopter la mauvaise réponse. Voilà une belle illustration des raisons transsubjectives. Ici, la croyance s'installe bien sur la base de raisons perçues comme suffisantes.
Autres exemples : les études de Shweder
Lorsqu'un consensus s'établit sur une idée fausse, on peut généralement émettre la conjecture qu'il en est ainsi parce que cette idée fait sens pour chacun, que chacun a des raisons d'y croire, et que, de surcroît, il peut facilement avoir l'impression que ces raisons sont dignes d'être partagées (6). Shweder (7) présente plusieurs expériences où des sujets à qui on propose d'examiner des données statistiques en tirent à une écrasante majorité des conclusions que les règles de l'inférence statistique n'autorisent en aucune façon. Il en conclut que la pensée ordinaire est "magique", au sens de Lévy-Bruhl. Autant les résultats de l'étude sont passionnants, autant cette interprétation est discutable (8). On propose à des infirmières un lot de 100 fiches supposées représenter chacune une maladie. On y a reporté des informations fictives : le patient présente/ne présente pas le symptôme S ; il est/n'est pas affecté de la maladie M. L'on demande alors aux infirmières si le symptôme S doit être interprété comme un symptôme de la maladie M.
|
Symptôme Maladie |
Malade |
Non malade |
Total |
|
Symptôme présent |
37 |
33 |
70 |
|
Symptôme absent |
17 |
13 |
30 |
|
Total |
54 |
46 |
100 |
Une correlation négative perçue comme positive
Les infirmières n'utilisent, semble-t-il, qu'une seule information pour déterminer leur réponse : la proportion des cas où le patient à la fois est atteint par la maladie et présente le symptôme. Ces cas sont "relativement fréquents" (37 sur 100). Mais cette seule information ne permet pas de conclure à une relation de causalité M =) S. En fait, la probabilité pour qu'un patient soit atteint est un peu plus faible lorsqu'il présente le symptôme que quand il ne le présente pas (37/70 = 0.53 ; 17/30 = 0.57).
D'où vient donc que les réponses aillent très majoritairement dans le mauvais sens ? D'où vient qu'une corrélation en réalité faiblement négative soit avec un bel entrain perçue comme positive ? On peut interpréter la conviction des infirmières comme résultant d'un effort pour maîtriser la complexité du problème, d'analyser leurs réponses comme faisant sens pour elles, comme dérivant de raisons. Ces dernières sont transsubjectives, et c'est ce caractère transsubjectif qui explique le caractère collectif de la croyance.
Voici quelle pourrait être l'analyse. Premier point : s'il est vrai qu'un tableau de contingence binaire comprend quatre informations indépendantes, en pratique on peut dans bien des cas conclure valablement d'une information unique à une relation de causalité. Cette situation est caractéristique notamment des phénomènes pathologiques : elle résulte du simple fait que le normal est plus fréquent que l'anormal. Pourquoi ce sentiment de certitude ? Il résulte tout simplement de ce que l'inférence est effectivement valide. L'interprétation de Boudon est donc que les infirmières se sont peut-être inspirées de ces cas, très fréquents dans la vie courante, où la simple constatation, même d'un petit nombre de coïncidences entre X et Y, permet de conclure valablement à l'existence d'une relation de causalité X =) Y.
|
Effets Soirées |
Non arrosées (¬ a) |
Arrosées (a) |
Total |
|
Pas de mal de tête (¬ t) |
[grand] |
0 |
[grand] |
|
Mal de tête (t) |
[petit] |
2 |
[petit] |
|
Total |
98 |
2 |
100 |
NB : "¬" désigne la négation.
Une information lacunaire n'interdit pas toujours l'inférence causale
Les infirmières ont pu, de façon métaconsciente, juger que la fréquence de la maladie est "faible", et que celle de tout "symptôme" particulier est également faible. Maladies et symptômes, étant des phénomènes anormaux, sont par définition des événements rares. Si le tableau avait été plus réaliste, plus conforme au réel en ce qui concerne ses effectifs marginaux, l'information selon laquelle les deux caractères - maladie et symptôme - se trouvent conjugués 37 fois sur 100 représenterait effectivement un sérieux indice de causalité.
Ecartons tout de suite une objection aussi peu pertinente que fréquente : les infirmières ne se tiennent évidemment pas le discours présent ; leurs raisons ne leur apparaissent pas avec la même clarté. Mais si l'on ne suppose pas l'existence, sur le mode métaconscient, de telles raisons, on ne comprend pas le caractère collectif de la réponse. La psychologie la mieux ecceptée a d'ailleurs un nom pour qualifier ces systèmes de raisons qui apparaissent sur le mode métaconscient : l'intuition. Rien n'autorise à tirer d'un cas comme celui-là l'idée que l'inférence statistique "ordinaire" obéirait à des "lois" venues d'on ne sait où, et qui seraient d'une autre nature que celles auxquelles obéissent les procédures d'inférence légitimes codifiées dans les manuels de statistique.
Dans les deux cas et dans tous les exemples que nous propose la psychologie cognitive, les sujets apparaissent comme faisant des conjectures raisonnables, des synthèses acceptables entre leurs informations. Bien sûr, les synthèses auxquelles parvient le sujet peuvent, comme le montrent ces exemples, être fragiles ou fausses. Dans les deux cas, elles sont transsubjectives : loin de provenir d'idiosyncrasies personnelles, elles tendent à s'imposer, parce que les raisons sur lesquelles elles s'appuient ont une force intrinsèque. Mais cette fausseté n'implique pas l'absence de raisons transsubjectives.
On peut parler de "rationalité cognitive" pour désigner le type de rationalité présent. Ces exemples suggèrent que, pour rendre compte d'une croyance collective, il est bien souvent inopportun de faire appel à des hypothèses supposant un effet mécanique de forces sociales mal définies sur l'esprit de l'individu. Il suffit de comprendre les raisons que chaque sujet ou chaque individu idéal-typique a d'endosser telle croyance.
Exemples tirés de la sociologie de la connaissance
Par contraste, les croyances dont traite la sociologie de la connaissance se caractérisent généralement par le fait qu'elles ne peuvent pas être comparées à une vérité objective. C'est pourquoi il est intéressant de se demander si elles relèvent du modèle cognitiviste.En lisant Tocqueville et Marx, lorsqu'ils expliquent pourquoi les sujets sociaux croient à telles propositions, sans prêter la moindre attention aux modèles irrationnalistes, ces deux auteurs recherchent spontanément les raisons qu'ils ont d'y croire.
Marx
Le cas de Marx est intéressant parce que, dans ses analyses de sociologie de la connaissance, il fait souvent le contraire de ce qu'il recommande dans ses textes doctrinaux. Dans Le Capital, il se demande pourquoi les prolétaires acceptent l'exploitation (9). A cette question, le néo-marxisme vulgaire propose une réponse verbeuse et irrationnelle du type de celles évoquées plus haut : parce qu'ils sont "aliénés". Or Marx lui-même ne l'évoque même pas. Son analyse suggère que, loin de s'appuyer sur le pouvoir occulte qu'aurait la classe dominante d'imposer ses vues aux prolétaires, ils acceptent l'exploitation parce qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Cette analyse propose une interprétation cognitiviste de la "théorie des groupes de référence". On peut retranscrire la démarche que Marx impute à un prolétaire idéal-typique sous la forme de l'argumentaire suivant :
| 1. Mon salaire est-il juste ? |
| 2. Mon salaire est juste s'il correspond bien à la valeur de mon travail. |
|
3. Il est impossible pour moi de déterminer cette valeur directement. |
| 4. Un système de rémunération juste est celui qui rétribue de façon identique ceux dont la production est identique. |
| 5. Un moyen de savoir si mon travail est payé à sa juste valeur dans mon entreprise consiste donc à comparer mon salaire aux revenus de ceux qui font à peu près la même chose que moi. |
| 6. Je travaille dans une boulangerie industrielle. Pour savoir si mon salaire est juste, je peux le comparer à celui du boulanger du coin de la rue. Je le connais assez pour avoir une idée relativement précise de son mode de vie. |
| 7. J'ai à peu près le même train de vie que lui. |
| 8. Donc mon salaire est juste. Il correspond à la rémunération naturelle de mon activité. |
L'analyse consiste d'abord à suggérer que le prolétaire part d'une théorie précise de la justice : à contribution égale, rétribution égale. Cette théorie de la justice lui apparaît comme une évidence car le salarié participe au système de production pour toucher un salaire ; quant audit salaire, il est censé rémunérer la contribution du salarié à la production. L'équivalence lui fournit un moyen indirect de déterminer la valeur de son travail, qu'il ne peut calculer directement. Mais une comparaison effectuée à l'intérieur de l'entreprise est insuffisante. L'ouvirer doit se comparer à un travailleur qui fasse à peu près la même chose que lui, dont par conséquent il puisse tenir la contribution comme égale à la sienne, et dont, d'autre part, il connaisse la rétribution. Bien sûr, cette comparaison néglige le fait que les coûts de production par unité sont plus faibles dans la boulangerie industrielle ; mais, pour le savoir, il faut avoir fait un peu d'économie : pas plus que le principe de conservation de l'énergie, l'effet de la division du travail sur les coûts de production n'est une vérité intuitive. En cons"quence, l'ouvrier-boulanger a tendance à sous-estimer la valeur réelle de son travail. Et c'est cette sous-estimation qui le conduit à ne pas voir qu'il est "exploité", que son travail est payé au-dessous de sa valeur.
L'analyse de Marx suggère bien que, si le prolétaire accepte l'exploitation, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Il adopte une théorie de la justice parfaitement acceptable. Elle lui suggère des "tests empiriques" lui permettant de savoir si son travail est payé à sa valeur. Ces tests sont biaisés. Mais il n'y a aucune raison pour que l'ouvrier perçoive cette distorsion, laquelle n'est clairement perceptible qu'à la lumière de théories économiques dont il n'y a pas lieu de penser qu'il puisse les subodorer à l'aide des seules ressources de l'intuition.
Tocqueville
Il traite les croyances collectives comme l'effet agrégé de croyances individuelles. Ensuite, il postule que restituer le sens de ces croyances revient à reconstruire les raisons qu'un acteur idéal-typique a de les endosser. A cette fin, il montre qu'elles dérivent d'un entrelacs de principes, d'évidences empiriques, logiques ou morales, dont certains sont universels, tandis que d'autres sont indexés sur le contexte.
Bref, la méthodologie de Tocqueville consiste à montrer que les croyances collectives dérivent d'une argumentation qu'aucun des acteurs réels n'a peut-être jamais littéralement développée, mais que l'on peut en toute vraisemblance imputer à un acteur idéal-typique. Dans L'Ancien Régime, il se demande pourquoi les intellectuels français de la fin du XVIIIe siècle ne jurent que par la Raison, et pourquoi leur vocabulaire et leurs idées se répandent aussi facilement. En fait, nous dit Tocqueville, les intellectuels de la fin du XVIIIe ont des raisons de croire à la Raison. Il se dégage le sentiment que les institutions sont inadaptées, confuses et dépourvues de raison d'être, que la tradition est mauvaise, que les hiérarchies sociales sont illégitimes, que la société est atomisée.
Pour Tocqueville, comme pour tous ceux qui se rattachent aux principes d'une méthodologie individualiste, une croyance collective ne s'explique que dans la mesure où elle fait sens pour un sujet idéal-typique, pour un individu quelconque.
Bien entendu, Tocqueville pressent bien les menaces de la planification et du "despotisme démocratique" dont ces croyances sont grosses. Mais il ne les interprête à aucun moment sur le mode irrationnel. Au contraire, le contexte français fait que les intellectuels ont de bonnes raisons d'y croire, tout comme leurs homologues anglais ont de bonnes raisons de ne pas y croire. Derrière la croyance à la raison et la disqualification de la tradition, Tocqueville décèle un argumentaire qui en fonde le sens pour l'acteur idéal-typique et explique ainsi qu'elle ait pu devenir collective.L'hypothèse de la contagion et de l'inculcation est d'ailleurs explicitement répudiée par Tocqueville :
"La rencontre de plusieurs grands écrivains disposés à nier les vérités de la religion ne paraît pas suffisante pour rendre raison d'un événement si extraordinaire ; pourquoi auraient-ils tous portés leur esprit plutôt de ce côté ?" (10)
L'irréligion résulte d'un syllogisme pratique diffus dont les prémisses sont traitées par chacun comme des évidences, de caractère soit analytique, soit empirique. C'est parce que chacun a des raisons solides d'être irréligieux que tous tendent à l'être. La croyance collective est l'effet agrégé des croyances individuelles, lesquelles résultent d'un système de raisons que tous perçoivent comme fortes. Tocqueville ne se contente pas d'affirmer, à la façon d'un Goffman (11), que l'irréligion est un "cadre" de pensée, ou, à la manière de certains psychologues sociaux, qu'elle est une "représentation sociale" venue d'on ne sait où, ou encore que toute société comporte des valeurs que le sujet se contenterait d'"intérioriser". Il ne se serait pas satisfait de telles explications, car elles négligent entièrement de rendre compte de la conviction des acteurs.
Pourquoi les Américains ont-ils échappé au mouvement européen d'irréligiosité qui caractérise la plupart des pays européens au XIXe siècle ? Parce que les Eglises américaines, étant nombreuses et concurrentielles, ont échappé à la tentation du politique et se sont inscrites dans le social, exerçant sur le terrain des fonctions de préservation de la santé publique, d'assistance sociale, d'éducation publique, ... que ni les autorités publiques ni les citoyens ne leur contestent. Elles font donc partie de la vie sociale de tous les jours : le citoyen n'a ici aucune raison de les rejeter.
En suivant le droit fil de la pensée de Tocqueville, on peut ainsi forger des conjectures plausibles permettant d'expliquer des différences qui, aujourd'hui encore, sautent aux yeux entre la "culture" américaine et les cultures européennes : la morale étant davantage détachée de tout dogme religieux, aux Etats-Unis comme au Japon (pour des raisons historiques différentes), elle est plus puissante et davantage partagée. L'analyse de Tocqueville garde aujourd'hui toute sa pertinence. (12) Si les travaux de Gerschenkron (13) constituent un guide efficace pour comprendre les idéologies, non seulement d'hier, mais d'aujourd'hui (14), c'est que, dans ses analyses comparatives, il adopte toujours une perspective cognitiviste : les tard-venus au développement que sont les Prussiens de la seonde moitié du XIXe ou les Russes de la fin du XIXe avaient peu d'intérêt, explique-t-il, à adopter une idéologie de type libéral. Le néo-mercantilisme, la protection des frontières commerciales, la constitution de marchés exclusifs, le dirigisme étaient des moyens plus appropriés à l'objectif de rattrapage qui s'impose facilement aux puissances attardées. Réciproquement, les idées nationalistes d'un Frédéric List ou d'un von Treitschke, ainsi que l'audience qui fut la leur, s'expliquent parce qu'elles faisaient sens pour beaucoup d'acteurs. (15)
L'influence du positivisme
Pourquoi le modèle cognitiviste est-il si peu utilisé ? Son rejet est sans doute dans une large mesure la contrepartie d'une conception étroite de l'argumentation, laquelle provient elle-même de l'influence du "positivisme".
Le "positivisme" est employé ici dans un sens à dessein vague, comme désignant les doctrines qui prétendent établir une ligne de démarcation franche entre la pensée scientifique et la pensée ordinaire (16). Cette influence a eu pour effet que l'argumentation scientifique tend à être traitée comme la seule capable de produire des convictions fondées. En un mot, le positivisme a conduit à donner le statut de l'évidence à l'idée que seules les raisons objectivement valides peuvent avoir une influence causale sur les convictions du sujet social.
|
Argumentation scientifique |
|
|
Raisons --> |
Croyances |
|
Argumentation non scientifique |
|
|
Raisons <--- |
Croyances |
Ce schéma est illustré de manière franche par Pareto (17), pour qui une argumentation ne relevant pas de la catégorie du "logico-expérimental" a nécessairement le statut d'un simple "vernis idéologique" dépourvu par principe de toute force de conviction et servant de couverture à l'action des "sentiments".
Cette vision binaire se heurte à une difficulté majeure, à savoir que l'argumentation scientifique n'a rien de spécifique. Elle est seulement, en principe du moins, soumise à une étiquette plus rigoureuse : elle doit se soumettre à des règles de présentation bien définies. Mais, pour le reste, les différences s'estompent : une argumentation morale peut être aussi solide qu'une argumentation scientifique. Bref, il n'existe guère de corrélation entre les domaines d'application de la démarche argumentative et la solidité des raisons qu'elle mobilise.
D'autres facteurs devraient bien sûr être évoqués pour rendre compte de la faible audience du modèle cognitiviste et de l'attraction des modèles irrationalistes : il est si simple, quand on ne comprend pas pourquoi tel individu croit X, de supposer qu'il est mû par des forces occultes. La plupart des auteurs qui évoquent ces forces irrationnelles se contentent de les nommer, sans jamais tenter de les identifier ni de leur donner le moindre contenu. Ces influences expliquent sans doute pourquoi les sciences humaines modernes paraissent avoir oublié la grande leçon de méthode des sociologues classiques à propos des croyances collectives : expliquer telle croyance collective, nous enseignent Tocqueville, Marx, Max Weber et les autres, c'est montrer qu'elle fait sens pour un individu idéal-typique, c'est-à-dire qu'il a des raisons solides de l'endosser.
Pour expliquer les croyances collectives, deux modèles apparaissent en fin de compte comme en concurrence permanente, celui qui prétend faire des croyances collectives le produit d'un processus d'"interiorisation" voué à rester à jamais conjectural, et le modèle wéberien, qui suppose que l'intériorisation de "X est juste" a lieu parce que le sujet a des raisons, exprimées ou non, de croire que "X est juste", et qu'elle doit par conséquent s'analyser comme un effet, et non comme une cause (18).
L'objection la plus fréquente à l'encontre de l'idée selon laquelle expliquer une croyance collective, c'est reconstruire les raisons que l'individu idéal-typique a de les endosser, est que l'individu reprend en fait à son compte toutes sortes de croyances dont il n'examine jamais les fondements (19). Sans doute tout Français croit-il que l'objet chaise est désigné en français par le mot "chaise", et endosse-t-il cette croyance de façon mécanique, sans s'interroger sur son bien-fondé ni se demander comment et pourquoi ce mot s'est formé. Ce mot lui apparaît comme une réalité (sociale) qu'il ne peut qu'enregistrer. En résulte-t-il que l'indignation devant le vol, l'anticléricalisme des révolutionnaires de 1789 ou la religiosité des Américains doivent s'analyser de la même façon ?
Une autre objection consiste à affirmer que la notion de "bonnes raisons" comporte une conséquence indésirable, à savoir qu'elle signifierait toute croyance. Mais "comprendre" ne signifie pas "justifier". D'ailleurs la même distinction entre "compréhension" et "justification" doit être introduite dans le cas des croyances qui, comme les croyances normatives (20), ne peuvent être dites vraies ou fausses. Car si l'on a traité plus haut des seules croyances positives (relatives à l'être), les considérations qui précèdent peuvent être étendues aux croyances axiologiques (celles qui portent sur le devoir-être).
Un problème essentiel, commun à la plupart des sciences humaines et sociales, est celui de l'explication des croyances non fondées objectivement. Il est au coeur des travaux de Pareto sur les phénomènes idéologiques, de la sociologie de la religion de Durkheim et de Weber, ou de la sociologie de la connaissance de Mannheim. Il se pose à propos des croyances normatives comme à propos des positives. Occupons-nous ici uniquement des positives. Il existe à leur sujet quelques modes d'explication majeurs. L'un d'entre eux est représenté par la théorie irrationnelle classique. Comme le dit superberment La Rochefoucauld : "L'esprit est toujours dupe du coeur". Cette théorie a été largement reprise par Pareto. Mais la théorie la plus importante, la plus utile peut-être, est celle qu'on peut qualifier de cognitiviste. S'il est intéressant de s'y arrêter, c'est qu'on la trouve surtout à l'état implicite.
Le fondement de la théorie cognitiviste
De façon générale, le sujet social se forme des opinions sur une multitude de sujets mobilisant toutes sortes d'a priori. Cette mobilisation le conduit en général à des solutions insatisfaisantes, mais ces instruments peuvent aussi être à l'origine de croyances douteuses. Dans ce cas, on dira : il croit à des idées fausses, mais il a de bonnes raisons d'y croire. La politique de lutte contre la drogue, le crime ou le chômage, la politique de développement industriel ou urbain mettent en oeuvre toutes sortes de représentations et de théories, lesquelles sont en général fondées sur de bonnes raisons. Ainsi, pendant des décennies, les courbes de Phillips semblèrent confirmer l'existence d'une corrélation positive entre l'inflation et l'emploi. Elles fournissaient aux responsables de la politique économique de bonnes raisons de croire que, en laissant filer l'inflation, on pouvait espérer réduire le chômage, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la corrélation en question n'avait rien de nécessaire et que, en fait, elle s'était évanouie. Mais il ne suffit pas de constater que telle théorie est mobilisée dans telle situation, il faut aussi comprendre pourquoi elle l'est. La conviction : "telle théorie, telle solution, telle représentation est la bonne" n'apparaît que si l'acteur a des raisons d'y adhérer qu'il perçoit comme solides. La psychologie cognitive est alors un auxiliaire sérieux de la sociologie.
L'exemple de Feldman-Simon
Supposons d'un expérimentateur joue devant un sujet à une partie de pile ou face en utilisant une pièce biaisée, ayant 8 chances sur 10 de tomber sur face et 2 de tomber sur pile (1). On demande au sujet de prédire les résultats. Il choisit, de façon aussi aléatoire que possible, la prédiction "face" 8 fois sur 10 et la prédiction "pile" 2 fois. Cette stratégie cognitive apparaît, à première vue du moins, comme judicieuse. Mais, si elle est bonne en général, elle est mauvaise ici. En effet, elle ne donne au sujet que moins de 7 chances sur 10 (exactement 68 sur 100) de deviner correctement les résultats de la partie de pile ou face jouée par l'expérimentateur, alors qu'en choisissant face tout le temps, l aurait eu 8 chances sur 10 de réussite. Cette croyance, où le sujet imite le modèle qu'on lui demande de reproduire, s'appuie sur de bonnes raisons. Sinon, on ne peut comprendre pourquoi la croyance fausse est endossée par une imposante majorité, en d'autres termes, pourquoi elle est collective.
Effets de position
Le sujet a tendance à utiliser telle conjecture parce qu'elle lui paraît aller de soi : il est d'autant moins porté à la remettre en question qu'elle lui paraît s'imposer. Selon l'un des points les mieux acceptés de la théorie keynésienne, voire de la théorie économique tout court, l'augmentation de la fiscalité aurait normalement des effets déflationnistes. En effet, en ponctionnant le pouvoir d'achat, elle provoquerait une baisse de la demande pour les biens et les services et finalement une baisse des prix. Or, lorsqu'on demande à des chefs d'entreprise si une augmentation de la fiscalité a, selon eux, des effets inflationnistes ou déflationnistes, une immense majorité d'entre eux choisit la première réponse. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils répondent par référence à leur situation immédiate : une fiscalité plus lourde pèse sur les coûts de l'entreprise, invitant le chef d'entreprise à tenter de répercuter cette hausse sur ses prix de vente. Il n'est pas sûr que cette croyance soit entièrement dénuée de fondement, mais il est certain que les chefs d'entreprise, la pensant fondée sur une expérience immédiate, lui accordent plus de confiance et surtout plus de généralité qu'elle ne mérite. Autre exemple : beaucoup de personnes sont convaincues que le progrès technique est en lui-même générateur de chômage. Citons notamment le mouvement luddite. L'influence positive du progrès technique sur l'emploi n'est visible qu'à un niveau global et abstrait, tandis que l'effet négatif est facilement perceptible au niveau local et peut même être décelé par une simple expérience mentale. Comme dans le cas précédent, celui qui croit que le progrès technique est en lui-même cause de chômage n'est donc nullement victime d'une illusion. Au contraire : il croit ce qu'il voit. C'est pour ces raisons, qui relèvent de la rationalité qu'on peut qualifier de "cognitive", et qui traduisent la présence d'un "effet de Gré", que beaucoup d'essayistes, voire de responsables politiques continuent de considérer le chômage comme un mal nécessaire, résultant mécaniquement du "progrès technique", et en concluent que la seule manière efficace de lutter contre le chômage est de partager le travail. Sans doute suffit-il d'évoquer le cas du Japon ou de la Suisse pour voir qu'une bonne politique économique et une politique d'éducation avisée peuvent avoir une incidence favorable sur les taux de chômage. Mais l'évidence selon laquelle l'automatisation "détruit l'emploi" est trop forte. Autre exemple : le succès étonnant avec lequel ont été accueillies les thèses scientifiquement indéfendables de Michel Foucault dans Surveiller et punir. Il provient de ce que les effets de désocialisation de la prison sont facilement perceptibles, alors que ses effets dissuasifs et sécuritaires sont à la fois non visibles et non mesurables. Cette double asymétrie explique qu'on puisse facilement convaincre un auditoire lorsqu'on affirme que la prison augmente la criminalité.
Dans les deux cas examinés ici (effet Feldman et effet de Gré) les croyances fausses sont le produit de la "rationalité cognitive", c'est-à-dire de la mise en oeuvre par le sujet de stratégies qu'il utilise normalement pour obtenir une maîtrise cognitive de son environnement, parce qu'elles le conduisent généralement à des résultats satisfaisants.
La théorie cognitiviste des croyances appliquée à la psychologie
L'on ne peut qu'être très impressionné par le caractère original, sérieux et instructif des résultats que cette discipline nous apporte sur ce chapitre de l'inférence naturelle. Un promeneur remonte un sentier de montagne le lundi, le redescend le mardi, en partant exactement à la même heure que la veille. En montant comme en descendant, il a cheminé de manière irrégulière. Il n'a jamais quitté le sentier. On demande à des sujets s'il existe un point tel que le promeneur y est passé exactement au même moment les deux jours. On observe alors : 1. que les sujets répondent très fréquemment que l'existence d'un tel point est "peu vraisemblable" ; 2. qu'ils parviennent à cette croyance en mettant implicitement en oeuvre une procédure consistant à examiner mentalement quelques-uns des points pouvant éventuellement avoir la propriété recherchée. Ils concluent à propos de chacun de ces points que la chance pour qu'il ait la propriété recherchée est nulle ; par induction, ils en tirent l'impression qu'aucun point n'a sans doute la propriété en question. Toutes ces considérations sont raisonnables, et, par là, compréhensibles. Mais le piège se referme sur le sujet parce que, dans la situation considérée, tous les points (qui sont une infinité) ont bien la propriété qu'il leur attribue, sauf un. Il existe un point répondant à la propriété.
La théorie cognitiviste des croyances appliquée à l'histoire et à la théorie des idées et des idéologies
Tocqueville fait apparaître un intéressant effet de Gré. Pourquoi les penseurs politiques français, à la différence de leurs homologues anglais, ont-ils tendance à traiter le politique comme la variable indépendante ultime, celle qui explique les autres ? Tout simplement, explique-t-il, parce que, en raison de la forte centralisation administrative qui caractérise la France, le politique, par le truchement de la toute-puissance de l'Etat, joue un rôle effectivement beaucoup plus grand qu'en Angleterre. A l'inverse, les analystes anglais font de la "main invisible" la source principale du changement social, parce que, la "société civile" étant plus indépendante en Angleterre, l'agrégation des initiatives individuelles y affecte l'ensemble du système de manière beaucoup plus déterminante.
La théorie cognitiviste des croyances appliquée à l'économie et à la théorie politique
Downs a montré qu'un acte aussi élémentaire que celui qui consiste pour l'électeur à voter pour le candidat ou le programme de son choix ne peut être guidé par des raisons objectives. L'électeur se décidera sur les principes inspirant les programmes politiques et optera pour celui qui lui paraît reposer sur les principes le plus proches des siens. Pour mesurer l'intérêt de cette analyse "cognitiviste", il est intéressant de noter que cette manière de faire scandalisait Hume, qui ne comprenait pas qu'un parti politique puisse être fondé sur des principes, ni qu'on puisse se décider pour tel parti parce qu'il souscrit à des principes qu'on approuve soi-même. Car Hume avait une vision étroite de ce que nous appelons la rationalité : pour lui, une politique ne peut être jugée que sur ses conséquences. La juger sur les principes, c'est mettre la charrue avant les boeufs. Cette analyse comporte une conséquence considérable : elle montre que l'idéologie (au sens de Downs : idées non fondées objectivement) est un ingrédient naturel de la rationalité politique.
La théorie cognitiviste des croyances appliquée à l'histoire et à la sociologie des sciences
L'histoire et la sociologie des sciences ont l'avantage de montrer que les mécanismes de la rationalité cognitive ne sont pas caractéristiques de la seule connaissance ordinaire ; connaissance scientifique et connaissance ordinaire procèdent par les mêmes voies. Car le déchiffrement de la complexité du monde passe par la formulation de conjectures plus ou moins fragiles, par l'utilisation de moyens plus ou moins efficaces pour tester lesdites conjectures, ces moyens étant choisis à partir d'a priori plus ou moins judicieux, etc. Il suffit d'évoquer cette intrication des raisons sur lesquelles s'échafaude la connaissance ordinaire pour comprendre qu'elle puisse aussi facilement produire des croyances fausses que des croyances vraies. S'agissant de la connaissance scientifique comme des autres formes de connaissance, les croyances germent sur un empilement de raisons. Or il n'y a pas de raison pour que cette cascade argumentative ne produise pas des idées fausses aussi bien que des idées justes. Il est impossible de comprendre le caractère "naturel" de l'erreur scientifique, si l'on ne voit pas que la connaissance ne peut se dispenser de passer par la mobilisation d'a priori, par l'utilisation de "cadres" conjecturaux.
Prenons un exemple : celui des relations causales qui fondent les mesures de prévention en matière de santé publique. L'urgence à trouver des remèdes pousse les milieux scientifiques à mettre en évidence des relations causales par exemple entre régimes alimentaires et risques, permettant de dessiner une politique de prévention. L'urgence invite à mobiliser d'abord les données facilement disponibles. Supposons alors qu'on observe une corrélation comme celle de la figure 1 entre la pratique alimentaire A et la maladie M. On en concluera que A cause de M et qu'il vaut mieux renoncer à A si l'on veut éviter M.
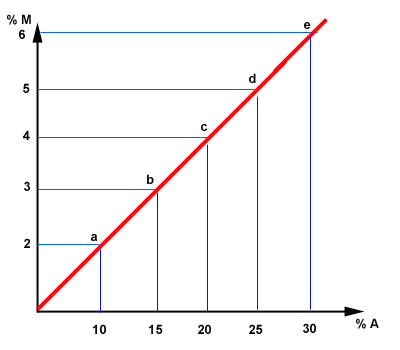
Une telle corrélation ne démontre rien. D'abord parce que rien ne prouve que les individus qui pratiquent A soient ceux qui sont malades. La deuxième raison est que, à supposer que A soit associée au niveau individuel à une probabilité plus forte d'être malade, la corrélation pourrait de nouveau être fallacieuse : si ceux qui manifestent la pratique alimentaire en question sont en moyenne plus pauvres et par là exposés à des conditions d'hygiène moins favorables, il est possible que ce dernier facteur, et non A, soit responsable de la corrélation.
La formulation de conjectures incertaines mais plausibles est une étape obligée de tout processus de connaissance. Les croyances collectives que nous venons d'évoquer, et qui apparaîtront demain comme des croyances fausses, sont des produits aussi naturels des processus de connaissance que les croyances qui seront ensuite validées et considérées comme des vérités. Dès lors qu'une telle croyance a été réfutée, comme c'est le cas par exemple quand l'observation directe vient contredire des données nationales, il est tentant de donner une interprétation irrationnelle de la croyance défunte et d'expliquer que les médecins qui l'ont endossé ont obéi à des règles d'inférence causale rappelant la "mentalité primitive" de Levy-Bruhl. Mais, en dehors de ses autres défauts, une telle interprétation est parfaitement invraisemblable.
La théorie cognitiviste des croyances et l'explication des croyances magiques
Les discussions relatives à l'explication des croyances magiques fournissent un témoignage particulièrement éloquent de l'importance de la théorie cognitiviste pour l'explication des croyances. Suivant le sens commun, beaucoup d'auteurs ont interprété les croyances magiques comme irrationnelles ("il n'y a vraiment pas de raisons de croire que A est cause de B, mais...") à partir d'une axiomatique de comportement qu'ils ne songeraient certainement pas à utiliser pour analyser les croyances fausses des hommes de science. Ainsi, selon Levy-Bruhl (2), les croyances magiques indiqueraient que le "primitif" a une constitution mentale différente de la nôtre. Cette cause expliquerait par exemple que le magicien confonde similarités verbales et similarités réelles, et de façon générale, relations entre les mots et relations entre les choses. Les croyances magiques sont analysées comme l'effet de causes inconscientes sur lesquelles l'individu n'aurait pas davantage de prise que sur les mécanismes physiologiques dont il est le siège. La cause explicative est inférée de manière circulaire à partir des effets qu'elle est supposée expliquer. Ainsi ceux que la théorie causale de Levy-Bruhl (3) laissaient insatisfaits ont souvent cherché à nier l'existence de ces croyances, plutôt qu'à en donner une explication "rationnelle" (au sens de la rationalité cognitive). La théorie selon laquelle les croyances magiques consisteraient en un simple mirage dont serait victime l'observateur a été défendue par exemple par le philosophe Wittgenstein (4), mais aussi par de nombreux sociologues et anthropologues modernes. Selon eux, il faut voir en ces prétendues croyances magiques l'expression symbolique d'un désir. Le primitif ne croirait pas réellement que tel rituel a pour effet de produire la pluie par exemple. Il exprimerait seulement par ce rituel son voeu de voir tomber la pluie. Mais, comme Horton l'a bien montré, cette théorie contredit les croyances des "primitifs" eux-mêmes, qui apparaissent comme absolument convaincus de l'efficacité de leurs rituels, bien qu'ils voient avec une parfaite clarté que ces rituels sont complémentaires des opérations techniques sans lesquelles - ils le savent bien - aucune plante ne pousserait.
En fait, la théorie de la magie de loin la plus acceptable est l'une des plus anciennes, à savoir celle qu'esquissent en des termes à peu près équivalents Durkheim et Weber. (5) Il s'agit d'une théorie rationnelle (au sens cognitif). Selon cette dernière, il faut d'abord reconnaître que le savoir du "primitif" n'est pas celui de l'occidental. Il n'a pas comme lui été initié à la méthodologie de l'inférence causale et n'a aucune raison de maîtriser les principes de la biologie ou de la physique. Pourquoi ferait-il une distinction entre le faiseur de feu et le faiseur de pluie ? En second lieu, la conduite de la vie quotidienne, mais aussi la production agricole, la pêche ou l'élevage supposent toutes sortes de savoir-faire : pour une part ceux-ci sont tirés, dans les sociétés traditionnelles comme chez nous, de l'expérience. Mais l'expérience ne suffit pas. Il faut que l'agriculteur ou l'éleveur mobilisent certaines représentations théoriques pour faire parler l'expérience. Or ils ne peuvent tirer ces représentations que du corpus disponible et considéré comme légitime dans leur société, notamment les doctrines religieuses. L'hypothèse de Durkheim - comme celle de Weber - est ainsi que ces doctrines jouent dans les sociétés traditionnelles le même rôle que la science dans les sociétés modernes. Le démenti du réel ne suffit pas à mettre un terme à ces croyances. Car, comme l'indique la thèse dite de Durheim-Quine, lorsqu'une théorie est démentie par le réel, on ne peut savoir d'avance ce qui dans la théorie est reponsable de cet état de choses. Si l'on accepte d'illustrer la théorie de Durkheim par un exemple contemporain, il nous suggère que les croyances magiques qui étonnent tant l'observateur ne sont pas plus difficiles à comprendre que la conviction aujourd'hui répandue selon laquelle la pollution industrielle aurait une incidence sur le climat. Dans un cas comme dans l'autre, la démonstration - ou la réfutation - de la relation causale est objectivement difficile. Durkheim suggère au total que les croyances magiques que l'on observe dans les sociétés traditionnelles ne sont pas d'une nature autre que toutes ces croyances en des relations de causalité mal confirmées qu'on observe dans les nôtres. Armé de cette théorie esquissée par Durkheim et Weber, on n'a pas de peine à comprendre que les pratiques magiques ne soient en aucune façon uniformément distribuées à travers les sociétés "primitives". On sait qu'elles sont par exemple peu répandues dans la Chine classique et dans la Grèce primitive. Cela est dû à ce que les doctrines religieuses en vigueur dans ces sociétés insistent sur les lois qui président au Cosmos, laissant peu de place aux formes capricieuses que la pensée magique met en oeuvre. Plus généralement, la cause de toutes ces croyances magiques est que l'inférence causale est une opération difficile, qui mobilise des a priori plus ou moins valides selon les cas, mais qui sont facilement traités comme allant de soi par le sujet social.
En résumé, nous ne dirons pas que les explications irrationnelles des comportements et des croyances sont toujours illégitimes. Il serait absurde de le prétendre. Mais seulement que le sens commun (comme les sciences humaines qui sur ce point ont bien de la peine à échapper à son emprise) a souvent tendance à abuser des explications irrationnelles.
Notes
1 : Aronson (E.), "Dissonance Theory : Progress and Problems", in : Abelson, Aronson et al., Theories of Cognitive Consistency : a Sourcebook, 1968.
2 : Douglas (M.), Parity and Danger : an Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, 1966 (en français, De la souillure : essai sur les notions de pollution et de tabou, La Découverte, 1992 ; Needham (R.), Belief, Language and Experience, 1972.
3 : Bloor (D.), Knowledge and Social Imagery, 1976 (en fr. : Socio-logie de la logique, 1982.)
4 : The Economist, 4 juillet 1992, p. 81-2 (présentation d'une recherche de L. Cosmides et J. Tooby de Stanford).
5 : La réponse correcte est : en l'absence de toute autre information, le sujet a, dans les conditions décrites, un peu moins de 2 chances sur 100 d'être effectivement atteint s'il est positif au test (NdC.)
6 : Boudon (R.), L'Art de se persuader.
7 : Shweder (R.A.), "Likeliness and Likelihood in Everyday Thought : Magical Thinking in Judgment about Personality", Current Anthropology, vol. 18, n°4, dec. 1977, p. 637-659.
8 : La résurgence constante de cette hypothèse de la "pensée magique", de la "mentalité prélogique", s'explique par son côté spectaculaire et inquiétant. Les travaux de la psychologie cognitive sont généralement présentés par les médiateurs et par leurs auteurs mêmes comme révélant des "anomalies" de la pensée.
9 : Boudon s'inspire ici de suggestions d'Elster (J.), Making Sense of Marx. Studies in Marxism and Social Theory, Cambridge University Press, 1985 (en français : Karl Marx. Une interprétation analytique, PUF, 1989).
10 : Tocqueville (A. de), L'Ancien régime et la Révolution.
11 : Goffman (E.), Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, New York, 1974.
12 : Bellah (R.N.), Beyond Belief. Essays on Religion in a Post-Traditionalist World, 1991 ; Chaves (M.), Cann (D.), "Regulation, Pluralism and Religious Market Structure : Explaining Religious Vitality", Rationality And Society, 4, 3 july 1992 ; Boudon (R.), "The Understanding of Religious Vitality Needs Additional Factors", Rationality and Society, 4, 4 october 1992.
13 : Gerschenkron (A.), Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays, 1962.
14 : Synder (J.), "Russian Backwardness and the Future of Europe", Daedalus, vol. 123, spring 1994.
15 : Greetz (C.), "Ideology as a Cultural System", in Apter (D.), Ideology and Discontent, 1964.
16 : Cette définition couvre aussi bien le positivisme de Comte que le néo-positivisme du Cercle de Vienne, ou le "rationalisme critique" de Popper. Elle n'abolit évidemment pas mes différences entre ces trois variantes.
17 : Il y a plusieurs lectures possibles de Pareto. La première, exotérique, est celle ici présente : les actions non logiques sont le plus souvent le produit des sentiments, même si elles sont couvertes par un "vernis idéologique", c'est-à-dire par des raisons fallacieuses. Mais l'on ne peut prendre cette interprétation trop au pied de la lettre, sous peine de ne pas comprendre pourquoi le Traité de sociologie générale inclut un véritable traité de rhétorique et d'argumentation (la théorie des "dérivations"). Cette théorie des dérivations suggère que les arguments sont de force inégale, que seuls certains procédés argumentatifs peuvent avoir une force de conviction, que, pour convaincre, un argument doit avoir une forme logique impeccable et dissimuler les glissements qui font que l'auditoire aura tendance à prendre un sophisme pour un raisonnement valide. De tels développements impliquent que, pour Pareto, les dérivations ont une force de conviction.
18 : Le paradigme interactionniste est illustré par exemple par Piaget (J.), Le jugement moral chez l'enfant, 1932 : deux enfants jouent aux billes, l'un triche ; le jeu perd son intérêt. Cette expérience induit dans l'esprit des deux le jugement "tricher est mauvais", qui aura maintes occasions d'être renforcé (ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas violé).
19 : Turner (S.), The Social Theory of Practices. Tradition Tacit Knowledge and Presuppositions, 1993. Cf. également Hayek (F.), La Constitution de la liberté, 1960 ; Droit, Législation et Liberté, vol.1. Règles et ordres, 1973, et le dossier que ce site consacre à Hayek. (NdC)
20 : Ce qui est juste, ce qui est injuste ; ce qui est honnête, ce qui est malhonnête ; ce qui est bien, ce qui est mal ; etc.. (NdC)
1 : Simon (H), Models of Bounded Rationality : Economic Analysis and Public Policy, Cambridge, The MIT Press, 1982. Feldman (J), "Simulation of Behavior in the Binary Choice Experiment", in : Feigenbaum, Feldman, Computers and Thought, New York, McGraw Hill, 1963, p. 329-346.
2 : Lévy-Bruhl (L.), La Mentalité primitive, 1922, PUF, 1960.
3 : On repère chez Levy-Bruhl la thèse "positiviste" reprise par Friedman (M.), The Methodology of Positive Economics : Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953, p.3-42, selon laquelle le sociologue et l'économiste peuvent décrire les principes du comportement humain comme ils l'entendent, pourvu que les conséquences de leurs théories soient compatibles avec les faits. Une telle épistémologie est intenable : une théorie arbitraire du comportement ne peut au mieux que produire par hasard des conséquences congruentes avec des faits limités et grossiers. Ainsi, la théorie de Lévy-Bruhl explique qu'il existe des croyances magiques, mais non leur distribution dans le temps et dans l'espace.
4 : Wittgenstein (L), "Bemerkungen über Frazer's The Golden Bough", in : Wiggershaus (R), Sprachanalyse und Soziologie, Frankfurt, Suhrkamp, 1975.
5 : Durkheim (E), Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 1912, PUF, 1979 ; Weber (M), Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1922.
wl:Raymond Boudon
| Accédez d'un seul coup d’œil aux articles consacrés à Raymond Boudon sur Catallaxia. |