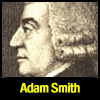Économiste et philosophe britannique (Kirkcaldy, comté de Fif (Écosse), 1723 — Édimbourg, 1790).
Fondateur de l'école classique d'économie politique, Adam Smith est surtout connu pour son ouvrage la Richesse des nations, dans lequel les principes du « laissez faire» économique — de la société marchande, selon sa formule — trouvent leur expression la plus accomplie. Smith soutient que la seule tâche du gouvernement est de maintenir l'ordre et la loi, en limitant au minimum les contraintes légales pesant sur le commerce et les prix. Ses écrits ont exercé une profonde influence sur nombre de théories économiques postérieures, qu'il s'agisse de celles de Ricardo ou de Keynes.
Sa vie
Le père d'Adam Smith exerçait les fonctions d'avocat et d'officier public ; sa mère était issue de la petite noblesse écossaise. De 1737 à 1740, Smith fréquenta l'université de Glasgow, où il suivit les cours de Francis Hutcheson, un professeur de philosophie morale réputé. Il demeura ensuite au Balliol College d'Oxford jusqu'en 1746, en qualité d'étudiant boursier, se consacrant surtout à des lectures personnelles. Ayant quitté Oxford, il donna des cours libres — en littérature, jurisprudence et philosophie, semble-t-il —à l'université d'Édimbourg de 1748 à 1751, date à laquelle il fut nommé professeur de logique à l'université de Glasgow. En 1752, il reprit la chaire de philosophie morale de cet établissement ; la philosophie morale comprenait, outre l'éthique et la théologie, un enseignement d'économie politique. Il rencontra alors un certain nombre des intellectuels et des scientifiques les plus marquants de l'époque, comme James Watt, qui travaillait alors à perfectionner la machine à vapeur, ou le philosophe David Hume, avec lequel Adam Smith resta lié toute sa vie et dont il fut l'exécuteur testamentaire.
En 1759, Smith publia The Theory of Moral Sentiments (Théorie des sentiments moraux), ouvrage qui constitue la base sur laquelle s'appuiera plus tard la Richesse des nations. Il y étudie la capacité qu'a l'individu de se former des jugements moraux, et il montre qu'un même individu peut être guidé à la fois par son intérêt personnel — ses passions — dans ses comportements économiques, et par la morale commune dans sa vie sociale. Il formule déjà la thèse, qui sera reprise dans la Richesse des nations, selon laquelle une «main invisible» pousse souvent chacun à agir en conformité avec les intérêts de l'ensemble de la société.
En 1763, il démissionna de son poste universitaire pour devenir le précepteur du jeune Henry Scott, troisième duc de Buccleuch, qu'il accompagna dans un périple en France, séjournant notamment à Toulouse et à Paris (1764-1766). Au cours de ce voyage, il rencontra Voltaire (à Genève), D'Alembert et les encyclopédistes français, Helvétius, François Quesnay, ou encore Turgot, qui eurent sur lui une grande influence. De retour en Grande-Bretagne, Smith consacra ses dernières années à l'étude, à la discussion et à l'écriture; il rencontra alors Edmund Burke, Samuel Johnson, Edward Gibbon. Smith exerçait par ailleurs les fonctions de commissaire des douanes pour l'Écosse.
La Richesse des nations (1776)
Ce livre, dont le titre complet est Une enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations) est souvent présenté comme l'ouvrage fondateur de la littérature économique moderne. Il déborde pourtant ce cadre, et trace une histoire, économique et sociale, de l'évolution historique des nations. Selon son auteur, «dans chaque pays, le principal objet de l'économie politique consiste à accroître la richesse et la puissance du pays». L'ouvrage est divisé en cinq livres. Le premier étudie les «causes du progrès des puissances productives du travail», et la façon dont les produits du travail se répartissent parmi la population. Le livre II est consacré au processus d'accumulation du capital. Le livre III est un résumé historique de l'évolution du progrès de la richesse dans diverses nations, depuis la fin de l'Empire romain. Le livre IV est une critique des théories mercantilistes. Enfin, le cinquième et dernier livre traite des finances publiques.
Le travail et la valeur
Smith rompt avec l'idée mercantiliste selon laquelle la richesse d'une nation se mesure à la quantité de métaux précieux qu'elle possède. Une nation s'enrichit lorsque le produit annuel du travail de sa population augmente, tandis que la plus grande possession de métaux précieux peut provenir de «la richesse accrue des mines qui approvisionnent le pays», et n'avoir aucun rapport avec la pauvreté ou la richesse de la population. Posséder de l'or ne peut être «la preuve de la pauvreté ou de la barbarie d'un pays donné au moment où on l'observe». Or les nations «civilisées et prospères» progressent et s'enrichissent, et Smith propose de découvrir les mécanismes qui conduisent à cet enrichissement.
La division du travail
L'application à grande échelle de la division du travail induit des gains de productivité, première cause fondamentale de la richesse des nations. Smith utilise une image économique devenue fameuse, celle de la fabrique d'épingles. Dix hommes employés à fabriquer des épingles, s'ils répartissent entre eux les différentes étapes de la fabrication, produisent un nombre incomparablement plus grand d'éplingles que si chacun d'entre eux devait effectuer tous les stades de la fabrication. La division du travail provient d'une compréhension par chacun de son intérêt propre : à l'étape de l'échange primitif, du troc, chaque individu cherche à échanger ce qui lui a coûté le moins de peine contre ce pour quoi il est le moins doué. Ainsi, selon la dextérité et l'habileté de chacun s'instaure une première division du travail, qui devient de plus en plus complexe. Mais «la division du travail est limitée par la taille du marché». À un certain stade de la division du travail, «ce n'est qu'à une toute petite partie de ses besoins qu'un homme peut pourvoir par le produit de son propre travail», et la nécessité de réaliser un plus grand nombre d'échanges dans la vie courante entraîne l'apparition de la monnaie.
La division du travail a cependant une contrepartie : elle abrutit les travailleurs qui y sont soumis, et Smith se préoccupe de leur état déplorable — alors même que la grande industrie n'en était qu'à ses premiers développements. Il ne semble pas que Smith ait compris qu'il vivait au seuil de la première révolution industrielle et il n'a pas envisagé le degré de division du travail que la mécanisation allait entraîner.
Valeur d'usage, valeur d'échange, prix réel
Une marchandise possède une «valeur d'usage» et une «valeur d'échange» qui sont souvent, pour un objet donné, extrêmement différentes : ainsi, «rien n'est plus utile que l'eau, mais on ne peut presque rien obtenir en échange de celle-ci. Un diamant, au contraire, n'a presque pas de valeur d'usage, mais on peut souvent obtenir une très grande quantité d'autres biens en échange». Smith s'attache dès lors à déterminer «en quoi consiste le véritable prix de toutes les marchandises».
«Le prix réel de toute chose, ce que toute chose coûte réellement à l'homme qui veut l'obtenir, c'est la peine et le mal qu'il a pour l'obtenir.» La valeur d'une marchandise quelconque se mesure à la quantité de travail, matérialisée dans des biens ou des services, que son propriétaire peut commander en échange de cette marchandise ; il s'agit de ce que Smith appelle le travail commandé, qu'il distingue du travail incorporé, qui est la somme du travail nécessaire à la production d'une marchandise. La valeur du travail est elle-même invariable ; le travail n'est pas semblable à une marchandise au sens où il aurait une valeur variable ; il est donc «le seul étalon fondamental et réel avec lequel on peut en tout temps et en tout lieu estimer et comparer la valeur de toutes les marchandises». La monnaie représente pour sa part le prix nominal d'une marchandise.
Salaires, profits et rente
Lorsque le capital s'accumule et que certains particuliers emploient des travailleurs contre un salaire, «la valeur ajoutée par les ouvriers aux matériaux se résout en deux parties : l'une paie leurs salaires, l'autre les profits réalisés par leur employeur». Smith précède donc Marx et sa notion de plus-value en montrant que le profit des capitalistes vient bien d'une partie non payée du travail, réfutant explicitement l'idée que le profit des employeurs correspondrait à un «travail d'inspection et de direction» : pour Smith, les profits ne proviennent pas de la quantité ou de la pénibilité de ce «prétendu travail d'inspection», mais ils sont «réglés par la valeur du capital engagé et sont plus ou moins grands selon son importance».
Smith suppose que l'importance de la population varie en fonction de la quantité plus ou moins grande de nourriture — de blé — disponible. La population augmente quand la nourriture devient plus abondante et décroît quand elle devient plus rare, de sorte que la part de chaque consommateur reste à peu près constante. «Dans des temps très éloignés l'un de l'autre, on trouvera que des quantités égales de travail se rapportent de bien plus près dans leur valeur à des quantités égales de blé, qui est la subsistance de l'ouvrier, qu'elles ne le font à des quantités égales d'or et d'argent, ou peut-être de toute autre marchandise.»
Smith considère le prix des marchandises comme le résultat des rétributions dues à ceux qui fournissent les différents moyens permettant de produire les biens en question. Le prix de chaque bien représente ainsi la somme de la rente, des salaires et du profit perçus respectivement par les propriétaires fonciers, les ouvriers et ceux qui possèdent la réserve de nourriture et les matériaux nécessaires aux ouvriers durant leur travail. Ce n'est pas seulement chaque prix particulier, c'est le revenu de la société tout entière qui est en dernier recours réductible à la somme des salaires, des profits et des rentes.
Le prix naturel d'un bien est la somme des salaires, des rentes et des profits naturels de ceux qui produisent ce bien, «naturel» signifiant ici conforme à la pratique moyenne ou habituelle de tous les travailleurs, propriétaires fonciers et entrepreneurs dans une région ou une société donnée, durant une longue période. La demande du bien en question est supposée n'avoir aucune influence. Le prix de marché, lui, est déterminé par le seul jeu de l'offre et de la demande, et ne doit pas nécessairement, à tel ou tel moment, être égal au prix naturel. Si le prix naturel dépend du niveau naturel des salaires, des profits et des rentes, Smith doit logiquement expliquer comment ceux-ci sont déterminés. Il les rapporte, premièrement, aux institutions en vigueur dans la société considérée ; deuxièmement, à ce que nous appellerions aujourd'hui les conditions dynamiques régnant dans l'économie : «l'état progressif, stationnaire ou décroissant de la société».
Ce sujet entraîne Smith dans de vastes développements sur les salaires, la population, les rentes, la formation du capital et le rôle de l'État, qui occupent les quatre derniers chapitres du livre I, y compris une «digression sur les fluctuations de la valeur de l'argent au cours des quatre derniers siècles».
Lorsqu'il analyse le mécanisme de fixation du salaire «naturel» du travail, Smith affirme que le salaire du travailleur doit être suffisant pour lui permettre de subsister et même, «dans la plupart des cas, être un peu plus que suffisant, autrement le travailleur ne pourrait élever une famille, et la race de ces ouvriers ne pourrait se maintenir au-delà de la première génération» — intuition que reprendra Marx avec la notion de «prolétariat». Face aux employeurs, bien moins nombreux qu'eux et qui peuvent donc se coaliser plus facilement, Smith prédit que les travailleurs auront toujours le dessous et devront se soumettre aux conditions des patrons. Il compare l'évolution des salaires avec celles de la population, du prix des moyens de subsistance, en fonction des régions et des périodes de l'année ; il conclut avec optimisme que l'augmentation du salaire, bien qu'entraînant un renchérissement du coût des marchandises, correspond à une amélioration des conditions de vie des travailleurs grâce aux gains de productivité. Pourtant, la concurrence que se font entre eux les employeurs, tend à faire baisser le taux de profit.
Le capital
Dans l'état primitif des sociétés humaines, l'accumulation de capital est inutile. C'est la division du travail qui nécessite de chaque travailleur d'amasser un petit capital, puis, la division du travail se perfectionnant, l'accumulation du capital prend une dimension plus importante, jusqu'à devenir une condition pour augmenter la capacité productive des nations les plus développées. Lorsque l'on cherche l'origine de l'accumulation du capital, on ne la trouve que dans la frugalité et la sagesse des particuliers, leur épargne.
Smith distingue trois parties dans le capital. La première est réservée à la consommation immédiate et ne rapporte aucun profit (stock). Le capital fixe rapporte un revenu sans circuler ; il s'agit des outils de travail (machines), des bâtiments et de tout ce qui peut bonifier une terre agricole, mais aussi de ce que Smith appelle «les capacités utiles acquises par tous les habitants ou membres de la société» — savoir-faire, talents, dextérité. Le capital circulant, enfin, comprend la monnaie, les réserves de vivres et de matériaux utilisés lors du processus de fabrication, ainsi que les marchandises elles-mêmes tant qu'elles sont encore dans les mains du marchand.
La monnaie présente, aux yeux de Smith, un caractère neutre et purement instrumental relativement au processus économique ; aussi la quantité d'argent mise en circulation est-elle déterminée par les besoins objectifs de l'économie. Il ne faut donc pas confondre la monnaie en circulation dans une nation donnée, et le revenu de cette nation : la monnaie ne sert qu'à distribuer ce revenu à chacun. Le revenu ne consiste pas en une quantité de monnaie, mais en ce que l'on peut se procurer grâce à cette quantité de monnaie. La richesse d'une nation ne provient pas d'une augmentation du capital dont elle dispose, mais d'une utilisation de ce capital à des opérations visant à augmenter l'activité productive. C'est parce qu'il concevait l'argent comme un instrument de circulation purement passif que Smith devait soutenir que l'exportation de métal monétaire n'est pas en elle-même dommageable ; elle est plutôt le signe qu'il existe au sein de la nation un surplus d'argent, dont l'exportation peut être comparée à une saignée salutaire pratiquée sur un malade.
Smith critique du mercantilisme
L'enseignement de Smith relativement à l'exportation d'argent ou d'or s'inscrivait dans une doctrine générale concernant la régulation du commerce. À l'époque où il écrivait, beaucoup croyaient encore que la vie économique — voire chaque acte économique particulier — devait, dans l'intérêt général, être soumise à d'importants contrôles. Il était couramment admis qu'une activité économique sans frein pourrait avoir — ou aurait même nécessairement — des conséquences dommageables pour de nombreux individus, pour la collectivité dans son ensemble et pour le souverain lui-même; cette idée était au centre de ce qu'on appelle le «mercantilisme». Il s'agissait de réguler l'activité économique dans le but principal de maintenir une balance commerciale excédentaire, avec tout ce que cela comportait.
Le mercantilisme, qui avait marqué la politique européenne depuis le XVIe siècle, était encore très répandu à l'époque de Smith, malgré l'émergence en France de l'école dite des physiocrates, qui prônait au contraire le laissez faire.
Smith estimait que les pratiques mercantilistes étaient le fait de classes particulières, dont elles servaient les intérêts spécifiques plutôt que ceux de la communauté dans son ensemble. Sans doute le mercantilisme appelait-il une vaste politique de régulation du marché intérieur, non moins que des mesures de contrôle du commerce extérieur, mais c'est surtout sur ce dernier aspect que Smith mettait l'accent. Il est connu pour sa condamnation du mercantilisme ou, pour le dire plus positivement, pour sa défense du libre-échange à l'intérieur comme à l'extérieur. Son propos, toutefois, n'a rien de doctrinal. Il critiquait tout spécialement l'instauration de monopoles, mais admettait l'utilité du contrôle à des fins, par exemple, de préparation militaire. Il était avant tout convaincu que l'harmonie entre les intérêts privés et les intérêts publics prévalait sur leur antagonisme. D'où il concluait que l'intérêt public n'est jamais mieux servi que lorsque les individus sont autant que possible laissés libres de rechercher leur propre profit. L'intérêt public est la résultante inintentionnelle d'une somme d'activités orientées chacune vers le profit individuel. Autant que l'interventionnisme commercial, les mesures de soutien à l'agriculture répugnaient à Smith. Il pensait que la nécessité naturelle dictait mieux que n'importe quel gouvernement l'ordre dans lequel les activités économiques devaient être entreprises, ainsi que l'importance relative qu'il convenait d'accorder à chacune. Toute l'histoire de l'Europe témoignait, à ses yeux, de la puissance que génèrent les efforts des hommes confrontés aux exigences de la nature. Ce n'est pas refuser tout rôle à l'État. Mais son champ d'intervention est à la mesure de l'étroite subordination dans laquelle la nature élémentaire de l'homme tient la sagesse et la vertu humaines.
Le rejet de la doctrine transcendantale
Plaidoyer en faveur du «capitalisme libéral», même si l'expression n'apparaît pas sous la plume de Smith lui-même, la Richesse des nations représente une rupture radicale avec les deux traditions alors fondamentales de la pensée européenne — à savoir les traditions morales issues de la philosophie grecque d'une part, de la Bible d'autre part. On peut dire que ces deux courants de pensée s'accordaient pour prescrire aux Européens un mode de vie fondé sur le respect du devoir ou, pour user d'un terme vieilli, sur un certain nombre de vertus. Celles-ci se trouvaient cautionnées par une doctrine de la nature humaine qu'on a souvent décrite comme une doctrine «transcendantale», selon laquelle l'homme doit être compris à la lumière de ses possibilités les plus élevées.
Mais pour soutenir cette volonté d'élévation ou pour traduire la notion de vertu sur le plan de la conduite quotidienne, il fallait que le peuple soit soumis à une autorité puissante et stable. Le peuple étant depuis toujours jugé incapable de se gouverner lui-même, l'autorité se trouvait répartie entre les princes séculiers et ecclésiastiques. L'idée dominante était que le plus grand des maux qui menacent l'humanité n'est ni l'assujettissement politique, ni la pauvreté, ni même la mort, mais le vice ou le péché.
Lorsque Smith qualifie son approche de «naturelle», ce terme, sous sa plume, comporte implicitement le rejet de toute la tradition transcendantale. Comme dans sa Théorie des sentiments moraux, Smith reprend la conception de la nature qui caractérisait la réflexion scientifique depuis le XVIe siècle, et pour laquelle tout phénomène, y compris dans la sphère humaine, est en dernier recours réductible au mouvement de la matière. La conservation de ce mouvement ou, s'agissant d'êtres humains (Homo œconomicus), la préservation de la vie, constitue pour Smith l'objectif suprême de la nature.
Le système le plus naturel, par conséquent, est celui qui organise le mieux la production des biens nécessaires à la vie. C'est parce que la division du travail augmente la productivité que cette forme d'organisation se recommande aux yeux de Smith.
Aussi ne découvre-t-on pas sans surprise les critiques qu'il adresse par ailleurs à la division du travail et au principe général de l'échange marchand. Le point de vue qu'il adopte ici est celui de la morale au sens large ; il note que la division du travail a des effets négatifs sur l'esprit et sur l'âme, que l'attention exclusive portée au profit n'est ni noble ni ennoblissante, et que la distribution des biens selon le mécanisme de l'offre et de la demande n'aboutit pas à un résultat parfaitement juste. Mais alors pourquoi, malgré ces profondes réserves, Smith défend-il le principe marchand avec un zèle qui lui vaudra d'être reconnu comme son principal champion ?
Le régime libéral, clé de la liberté
On peut trouver une amorce de réponse à cette question en rapprochant les spéculations de Smith sur l'histoire et son analyse des structures politiques formelles dans le Livre V de la Richesse des nations. Le changement historique se produit quand les hommes cherchent à satisfaire leur passion pour le profit et l'ascension sociale. La meilleure façon de mouvoir les masses humaines est de leur promettre qu'elles disposeront en quantité suffisante, voire surabondante, de ce qu'elles recherchent le plus — les moyens d'existence. Pour Smith, c'est le libéralisme qui est le mieux à même de satisfaire ces promesses, et c'est donc dans cette direction qu'il faut pousser la société. Mais l'établissement d'un régime libéral va de pair avec le relâchement des liens séculiers et ecclésiastiques que la tradition européenne considérait comme la condition indispensable d'une vie commune tolérable.
Smith pensait avoir résolu le problème de la liberté et de l'ordre par la formule suivante: remettez les individus à la garde de leurs propres passions — dont rien ne peut, de toute manière, les affranchir — et, une fois installés les freins institutionnels nécessaires à la canalisation des conflits, ils se trouveront amenés, par intérêt personnel, à faire ce qui est requis pour le bien de la communauté. Le capitalisme constitue sur le plan économique — et par suite transéconomique — la prémisse historique du libéralisme politique, démontrant ainsi qu'il est préférable de s'en remettre à des motifs intérieurs plutôt qu'à des contraintes extérieures.
La «main invisible»
La théorie de la main invisible qui oriente les actions des individus dans un sens favorable à la collectivité est issue de la Théorie des sentiments moraux. En économie politique, Smith montre que même si chaque individu, chaque entrepreneur, ne cherche que son propre profit, ce profit personnel s'accorde néanmoins avec les buts de l'industrie nationale. En cherchant à accroître son revenu personnel, chacun contribue finalement à accroître le revenu de la nation. Chacun est «conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions, et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions» car on travaille de façon plus efficace lorsque l'on croit poursuivre son propre profit que s'il s'agissait du bien général. Améliorer son propre sort est un «désir qui nous vient dès notre conception, et qui ne nous quitte jamais que dans la tombe», mais cette concurrence qui dresse chacun contre chacun est bénéfique à la société tout entière.
L'influence de l'ouvrage
La Richesse des nations est réputé comme un chef-d'œuvre de la littérature économique. L'ouvrage aborde un grand nombre des sujets et des problèmes qui ont occupé depuis, et occuperont peut-être toujours les sciences sociales. La théorie smithienne de la valeur, de la population et de la distribution exerça une profonde influence sur les écrits de Ricardo, de Malthus, de Marx et de leurs contemporains. En rapportant la richesse de la nation à son revenu annuel, Smith marqua de manière indélébile la substance même des sciences économiques. Ses réflexions sur les finances publiques, sur la nature des coûts et sur quantité d'autres sujets resteront toujours pertinentes.
L'ouvrage de Smith proposait un enseignement global qui allait avoir une influence immense aussi bien sur la pratique des gouvernements que sur les opinions individuelles, et le livre dans son entier représente une application particulièrement brillante de principes abstraits à des circonstances concrètes. Ces principes généraux étaient apparus séparément chez divers auteurs, depuis Machiavel jusqu'à Hume. Leur juxtaposition, dans la Richesse des nations, à une doctrine économique pénétrante et solide explique le puissant intérêt de ce livre.